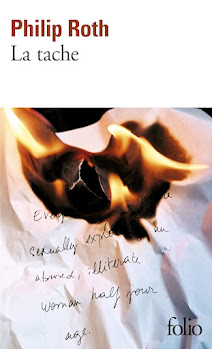Dans le sud de l’Australie, Jessica (Cassandra Delaney) s’occupe d’une réserve naturelle dans le bush avec son mari Ted. Cependant ce dernier est absent et la jeune femme va vite être confrontée - sur la route d’abord - à trois chasseurs de kangourous qui ont décidé de faire d’elle une nouvelle proie...
Fair Game est un film qui marque les quasis derniers feux de la Ozploitation, tout un courant de cinéma d’exploitation ayant marqué les esprits à l’orée des années 70/80. Dans ce statut de stade terminal de ce mouvement, la vision de Fair Game ravive le souvenir de nombre de films cultes mais sans en avoir la profondeur. Une tumultueuse poursuite routière en ouverture rappelle ainsi le rapport à la route et à la voiture chaotique inhérent à la société australienne, mais sans réellement en être un instantané comme le fut Mad Max de George Miller (1979). La barbarie, le machisme et la soif de sang des autochtones notamment durant les chasses au kangourou font figure de péripétie ou de gimmick, sans avoir la dimension anthropologique de Wake in fright de Ted Kotcheff (1971). L’immensité et la beauté des paysages de l’outback n’ont pas ici la mystique et le sens de l’Histoire de Walkabout de Nicolas Roeg (1971). En définitive, Fair Game est un digest visuel visant avant tout l’efficacité, que l’ont peut associer à un autre succès local récent comme le Razorback de Russel Mulcahy (1984).
S’il n’y a donc absolument aucune surprise à attendre pour le connaisseur d’Ozploitation, Fair Game s’avère en tout cas un survival d’une redoutable efficacité. Avec cinq fois moins de budget qu’un Mad Max 2 (1981) ou Razorback justement, le résultat est particulièrement impressionnant. L’histoire revient en quelque sorte à »l’os » de nombreux films d’Ozploitation, avec ici l’opposition entre Jessica (Cassandra Delaney), jeune femme en charge d’une éserve naturel dans le bush, et trois chasseurs rustres et machistes bien décidés à punir son franc parler à leur égard. Tout le film n’est qu’une longue escalade d’invectives, d’intimidation et d’agression conduisant à un combat féroce entre la belle et les trois péquenauds. Rien de plus, rien de moins mais porté par une exécution remarquable.Les paysages et leur horizon à perte de vue symbolisent une zone de non-droit où domine la loi du plus fort, un terrain de jeu pour les chasseurs et une prison à ciel ouvert aux cachettes limitées pour Jessica. Quand elle arpente ce décorum, les courses verticales en font une cible à portée de fusil de ses assaillants dans le travail sur la profondeur de champs, et un jouet avec lequel on s’amuse quand elle fuit la monstrueuse camionnette cette fois dans la largeur horizontale du cadre. Les rares scènes d’intérieur ou du moins les rares moments de promiscuité physique entre poursuivants et poursuivie laisse planer le spectre du voyeurisme (la photo dénudée prise à l’insu de Jessica) et du désir sexuel, même si étonnamment le film ne s’aventure pas plus loin dans ce registre crapoteux. Il s’agit de mettre au pas et d’humilier cette femme, mais autant pour son sexe que pour son statut d’autorité citadine et réfléchie voulant les freiner dans leurs habitudes barbares et décérébrées.Qualifier le film de féministe serait un bien grand mot, mais en tout cas l’interprétation intense et le charisme de Cassandra Delauney en font une figure attachante et authentique pour lequel on s’émeut. Tout comme les façons brutales des chasseurs vont en graduant, Jessica passe de la victime apeurée à l’amazone farouche bien décidée à se défendre. Le film travaille une sorte inquiétante étrangeté dans la fascination qu’exerce le paysage, passant de sauvage à surréaliste grâce à la somptueuse photo de Andrew Lesnie (qui allait faire un sacré chemin puisque bien plus tard il officiera sur la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson), notamment d’incroyables séquences nocturnes. Les cascades sont assurées par Glenn Boswell, qui après avoir officié sur Mad Max 2 et Razorback allait briller à Hollywood notamment sur Matrix Reloaded et Matrix Revolutions. Les chorégraphies se plient ici à l’esprit bas du front des chasseurs, tout à leur volonté de destruction de l’espace civilisé que s’est façonné Jessica dans l’outback, mais aussi de la briser mentalement lorsqu’il vont l’attacher à demi-nue sur le part-choc de leur 4x4 et l’humilier en la traînant ainsi à toute allure. Mario Andreacchio trouve constamment les angles les plus dynamiques pour mettre en valeur ce chaos, puis iconiser Jessica lorsqu’elle se rebiffera sévèrement lors du climax. Le découpage est très efficace, laisse longuement se dérouler les séquences les plus ravageuses (la destruction de la maison, le toit qui s’écroule avec un chasse s’en écartant à la dernière minute) ou alors laisser exploser la violence de façon expéditive.Fair Game se fait donc l’héritier d’une certaine tradition, et même sans égaler les œuvres qui l’ont précédé, s’avère un point final satisfaisant de ce mouvement. Le film ne rencontrera pas son public en Australie mais deviendra culte à l’international, l’ultime succès sous cette forme de l’Ozploitation puisque l’évolution des financements locaux condamneront ce type de films au marché vidéo – même si des réminiscences très réussie feront surface dans les années 2000 comme Wolf Creek de Greg McLean (2005).Sorti en bluray français chez Le Chat qui fume